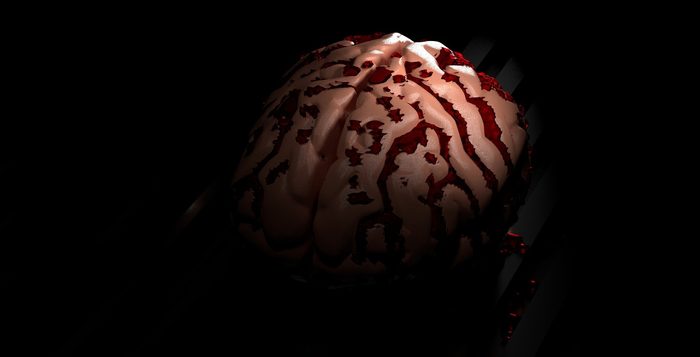Bonjour, c’est Sebastian Dieguez, chercheur en neurosciences à Fribourg, pour vous donner mon Point de vue.
Le vendredi, c’est le jour où votre newsletter laisse place à une chronique, sur l’international, la politique, la justice climatique ou, en ce qui me concerne, la cognition.
Aujourd’hui, voyons comment ma discipline, après les avoir longtemps ignorées, s’intéressent à la diversité de nos cerveaux et de nos perceptions. Et il y a beaucoup à en dire! |
Avant d'entrer dans le vif
|
|
Les neurosciences ont ouvert les yeux et c'est heureux
|
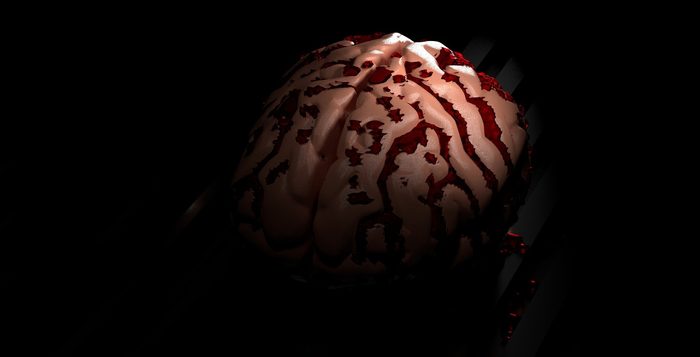
Pixabay / krzysztofmika
|
|
🌐 Lire en ligne 🌐
Si vous fermez les yeux, que voyez-vous? A priori, la réponse à ce test assez simple ne devrait pas créer trop de controverses: rien, pardi! Et pourtant, la question a soulevé nombre de spéculations au 19e siècle. Certains affirmaient que même les paupières closes, on voit toutes sortes de choses: des espèces d’échiquiers, des cercles concentriques, des rubans mouvants, des étoiles scintillantes, des flashes colorés.
D’autres soutenaient qu’on ne voit rien, mais différentes sortes de «rien»: du noir, du gris, parfois du blanc, ou même rien du tout… La question n’est à ce jour pas résolue, mais en gros, ce qu’on «voit» les yeux fermés dépend des gens et des circonstances.
Voilà une conclusion qui ne plaît en général pas aux scientifiques. En neurosciences, par exemple, on cherche à expliquer comment fonctionne le cerveau, et pendant longtemps, cette approche a permis d’enrichir nos connaissances sur son anatomie, ses fonctions et ses pathologies. Bien sûr, tout le monde est différent, mais à force de recoupements, de moyennes et de régressions, on parvient à déterminer en quoi consiste le cerveau moyen.
De fait, on a même tout fait pour ne pas trop s’éloigner de ce modèle idéalisé: la quasi-totalité des études ont ainsi été menées sur des jeunes hommes droitiers, occidentaux et éduqués.
On pensait ainsi s’épargner les complications fâcheuses que ne manqueraient pas de produire des échantillons trop hétérogènes. Mais, ce faisant, on réduisait évidemment «le» cerveau à celui d’une portion franchement minoritaire de la population humaine.
Quand les neurosciences ouvrent le spectre
La discipline en appelle aujourd’hui à une approche plus inclusive, embrassant la notion de diversité. Non comme un écueil méthodologique, mais comme un principe directeur. Il se trouve que le cerveau des gauchers, des femmes, des minorités, des classes défavorisées et des personnes issues d’autres cultures a tout de même des choses à nous apprendre. Et qu’ils sont tout autant concernés par les applications en médecine, dans l’éducation, les technologies ou la politique.
Ce progrès, considérable et dans l’air du temps, ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin.
En effet, la diversité n’est pas toujours visible, et n’a souvent rien d’évident. Reprenons notre exercice: fermez les yeux, puis bougez votre main devant votre visage. Percevez-vous du mouvement? Si oui, vous êtes sujet à l’«illusion du spéléologue». Des études contrôlées ont montré que ce phénomène touche environ la moitié des gens, mais 100% des personnes douées de synesthésie – celles qui voient les notes de musique en couleur, «goûtent» les lettres, ou encore entendent» les mouvements…
Des singularités que l’on prenait comme des lubies ou de pittoresques anomalies apparaissent aujourd’hui comme des expressions légitimes et normales de la diversité humaine. Certaines sont restées masquées par simple ignorance. Dans une étude, tous ceux qui voyaient du noir en fermant les yeux croyaient qu’il en allait de même pour tout le monde, et aucun de ceux qui voyaient des formes ne pensait qu’il puisse en aller différemment chez autrui.
Le cerveau, cette cour des miracles
Toujours plus étrange, les chercheurs s’intéressent depuis quelques années à des franges atypiques de la population:
- les «aphantasiques» (jusqu’à 4% de la population), qui ne peuvent «visualiser» quoi que ce soit dans leur tête,
- les «endophasiques», qui ont une «petite voix intérieure»,
- les «hyperthymésiques» qui vous disent immédiatement ce qu’ils portaient et le temps qu’il faisait le 4 avril 2003,
- les «super-reconnaisseurs», qui ont des capacités de reconnaissance faciale hors du commun,
- ou au contraire les «prosopagnosiques congénitaux», incapables de reconnaître le moindre visage.
Il reste quantité d’autres curiosités cognitives qu’on commence seulement à découvrir.
Donc non, la diversité n’est pas un vain mot. En neurosciences, elle permet de développer de nouvelles hypothèses, de mettre à l’épreuve les théories existantes, de sortir d’une vision pathologisante des différences, et nous force à prendre en compte le type d’environnement qui permet au mieux de l’exprimer et d’en révéler les nuances.
Il est temps d’en finir avec le cerveau, et d’embrasser la richesse, et même l’étrangeté, des multiples manières de se représenter et d’interpréter le monde. Sans cela, on risque d’avancer… les yeux fermés.
🌐 Lire sur Heidi.news 🌐 (FR)
|
|

Le journaliste scientifique Steve Silberman. | Photographie: Tanya Rosen-Jones.
|
|
«Les personnes autistes n’ont pas besoin d’être soignées, mais soutenues».
Steve Silberman est un journaliste scientifique américain connu pour ses contributions au magazine Wired. Son livre Neurotribes, paru en 2015 aux Etats-Unis et en 2020 en France, a été récompensé du prestigieux prix littéraire Samuel-Johnson. Il y apporte une contribution essentielle sur la perception de l’autisme en développant le concept de neurodiversité, ouvrant la voie à une meilleure intégration des personnes autistes dans la société. Retrouvez notre entretien.
Heidi.news (abonnés) (FR)
|
|
Il est temps de raconter le monde
|
|
|
L’aphantasie, ou l’incapacité de se représenter une image mentale.
L’aphantasie, c’est l’incapacité plus ou moins marquée à se représenter une image mentale. Une singularité identifiée dès la fin du 19e, mais qui n’est redevenue que tout récemment un sujet d’études, sous l’influence du psychologue et chercheur en neurosciences Joel Pearson, fondateur du Future Minds Lab à l’Université de Sydney. Retrouvez à ce sujet la chronique de CQFD, l’émission scientifique de La Première, à écouter en podcast.
CQFD (RTS, accès libre) (FR)
|
|
Portrait d’un hyperthymésique.
Joey DeGrandis est capable de se remémorer instantanément le moindre détail de sa vie, avec une précision à faire pâlir d’envie les GAFAM. En 2017, le quotidien britannique The Independent faisait le portrait de ce jeune Américain qui vit, de facto, dans un monde assez différent de vous et moi. Un monde où rien ne s’efface…
The Independent (accès libre) (EN)
|
|
Ces voix intérieures qui nous animent.
Vous l’avez déjà sans doute expérimenté, ce narrateur intérieur. Cette voix qui verbalise nos pensées, comme si l’on avait besoin de nos propres oreilles pour s’entendre. Comme souvent, les neuroscientifiques essaient de la comprendre en s’intéressant aux cas exceptionnels: ceux qui n’entendent jamais leur petite voix. Le magazine Discover revient sur les recherches en cours.
Discover (accès libre) (EN)
|
|
Un mot sur notre chroniqueur
|
|
Sebastian Dieguez est docteur en neurosciences, il enseigne à l’Université de Fribourg. Ses recherches portent sur la formation des croyances et le complotisme. Il est l’auteur de Croiver: pourquoi les croyances ne sont pas ce que l’on croit (éd. Eliott, 2022), Le Complotisme: cognition, culture, société (éd. Mardaga, 2021) et Total Bullshit: au coeur de la post-vérité (PUF, 2018), ainsi que de chroniques dans l’hebdomadaire satyrique Vigousse.
|
|

|
|
Avenue du Bouchet 2
1209 Genève
Suisse
|
|
|
|